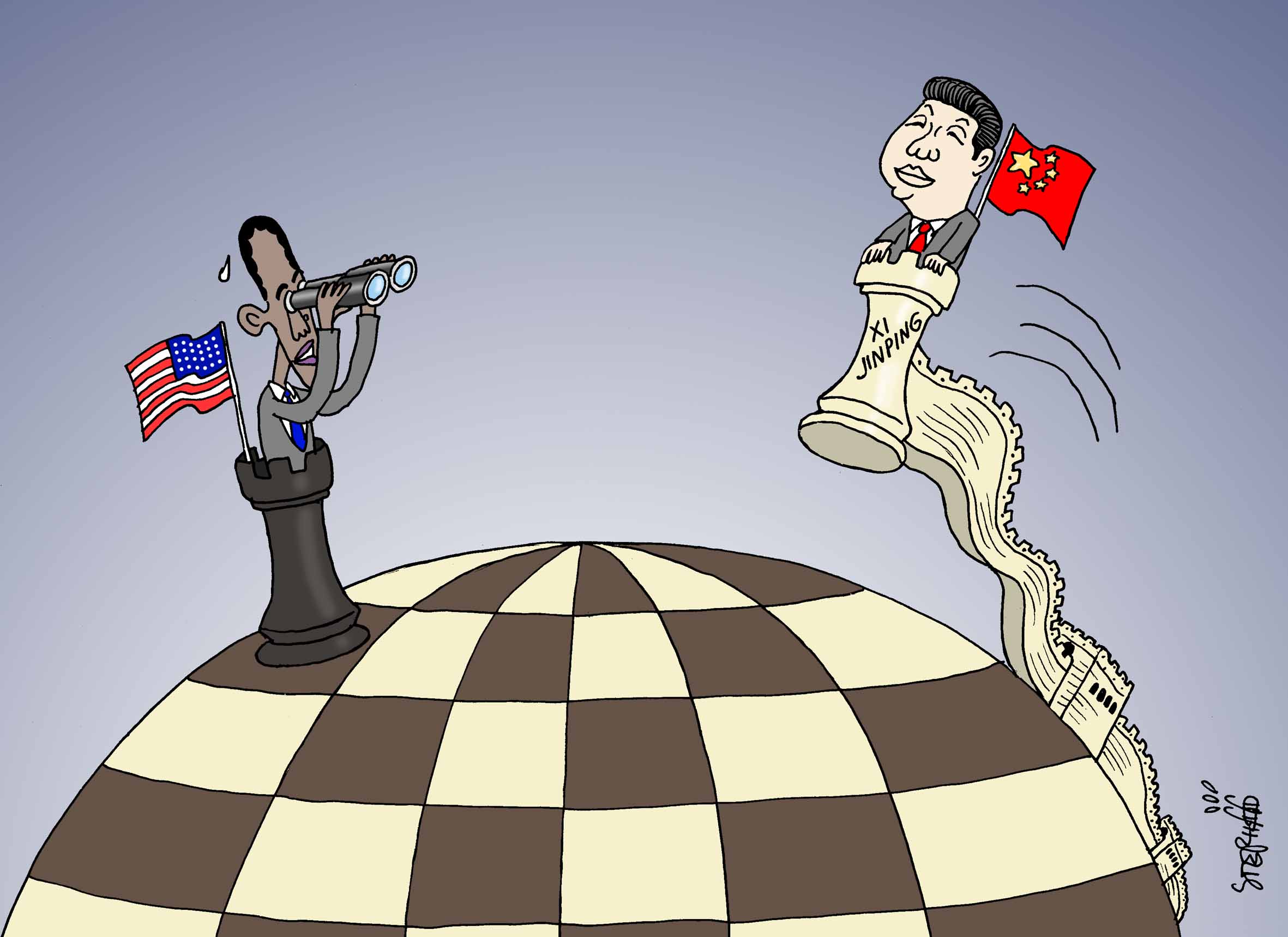Le débat sur l’utilisation des termes Birmanie ou Myanmar pour désigner le pays se poursuit alors même que celui-ci s’ouvre au monde.
Choisissez votre terme et chacun saura dans quel camp vous vous situez. Du moins, c’est la perception qui a prévalu entre le moment où la junte a officiellement changé le nom international du pays de Birmanie à Myanmar en 1989 et le début de l’ouverture politique à la mi-2011. Pour les opposants à la dictature, persister à nommer le pays “Birmanie” était une façon subtile de mettre en cause la légitimité du régime. Le fait que l’opposante Aung San Suu Kyi ait toujours insisté sur sa préférence pour “Birmanie” renforçait le caractère politique de ce choix sémantique.
Maintenant que le pays, sous l’égide d’un gouvernement civil issu d’une élection en novembre 2010 contestée par la communauté internationale, se libéralise, le débat sur l’utilisation de l’un ou l’autre terme devient plus complexe. Et les leaders en visite doivent parfois se livrer à des exercices de haute-voltige linguistique pour ménager les différents acteurs politique du pays.
Ainsi, rappelle le quotidien Los Angeles Times, lequel consacre un long article à ce sujet dans son édition du 24 décembre, la secrétaire d’Etat américaine Hillary Clinton a réussi à ne prononcer aucun des deux termes, lors de sa visite historique en 2011, optant pour l’appellation neutre de “ce pays”. Plus hardi, le président Barack Obama a semé quelques “Myanmar” lors de sa venue en novembre 2012, usant toutefois du mot “Birmanie” lors de ses contacts avec Aung San Suu Kyi et les autres membres de l’opposition. Selon le quotidien américain, les deux termes dérivent d’un mot commun, la seule différence véritable étant que “Myanmar” est plus formel et plus littéraire alors que “Birmanie” est un terme vernaculaire. La jeune génération, qui n’a connu que le régime militaire, utilise généralement “Myanmar” (Myanma en birman), alors que quelques anciens et les Birmans exilés tendent à préférer “Birmanie” (Bama en birman). Le quotidien en conclut que les deux termes coexisteront durant de nombreuses années, avant que “Myanmar” finisse par s’imposer.